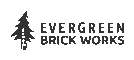L’impératif du rétrofit en profondeur : le Canada peut-il se permettre d’ignorer l’efficacité énergétique?

Cet article est également disponible in English.
Lorsqu’on parle de la conservation de l’énergie, nous oublions souvent de mentionner l’un des efforts les plus importants que nous pouvons entreprendre : la rénovation et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Mostafa Saad explique l’importance de rénover les bâtiments au Canada en répondant à la question: « Comment les rénovations énergétiques en profondeur peuvent réduire la demande, renforcer la résilience et soulager les contraintes du réseau? »
Le Canada se trouve à un moment charnière dans l’évolution de son secteur du bâtiment. D’un côté, le besoin urgent de nouveaux logements exige une construction rapide et soutenue. De l’autre, un constat moins visible, mais tout aussi crucial, s’impose : la majorité des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà debout aujourd’hui. Ces structures existantes représentent à la fois un défi de taille et une occasion extraordinaire dans la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.
La situation est claire : 56 % des bâtiments résidentiels et 70 % des bâtiments commerciaux et institutionnels au Canada dépendent encore des combustibles fossiles. Cette dépendance persiste malgré les progrès remarquables effectués par l’infrastructure énergétique du pays, notamment la transformation en profondeur de ses réseaux électriques.
Au fil des ans, les réseaux électriques canadiens ont drastiquement réduit leurs émissions, d’environ 75 %, en s’éloignant d’une époque largement dominée par le charbon. Cette évolution vers une électricité plus propre a ouvert la voie à une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. En réponse, ce dernier s’est de plus en plus tourné vers ce que l’on appelle la « conversion énergétique », c’est-à-dire le remplacement des systèmes alimentés par des combustibles fossiles par des équipements électriques.
Pourquoi la transition énergétique ne suffit pas
À première vue, la conversion énergétique semble une solution évidente : on remplace l’ancien équipement, on se branche à l’électricité plus propre, et on observe la baisse des émissions. Toute fois, cette approche, bien que bénéfique, reste trop simpliste si elle est appliquée isolément. Les données racontent une histoire plus nuancée. Entre 1995 et 2022, la consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels du Canada a augmenté d’environ 50 %. Changer simplement de source d’énergie n’a pas réellement freiné la demande globale.

Prenons l’exemple des nouveaux bâtiments commerciaux. Malgré un gain notable en efficacité énergétique au pied carré, ces améliorations n’ont pas entièrement compensé l’augmentation globale de la consommation d’énergie. Entre 2000 et 2021, la superficie de plancher du secteur commercial a augmenté d’environ 27 %, tandis que la consommation d’énergie grimpait de 21%. Certes, c’est une croissance plus lente, mais tout de même en hausse, ce qui soulève une question cruciale : ces progrès sont-ils réellement suffisants pour que le Canada atteigne ses cibles climatiques et énergétiques?
Pendant des années, l’accent mis sur la conversion énergétique a éclipsé l’importance de stratégies visant à réduire de façon permanente la quantité d’énergie consommée par les bâtiments. Les rénovations majeures entreprises depuis les années 2000 le montrent bien. Bien que le parc immobilier ait réduit ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 25 % grâce, entre autres, à la conversion énergétique, de nombreux bâtiments ont manqué l’occasion de mettre en œuvre des améliorations d’efficacité énergétique fondamentales.
Parmi ces occasions manquées figurent l’amélioration de l’isolation, l’étanchéisation, ainsi que d’autres optimisations physiques qui diminuent la demande de base en énergie. Contrairement à la simple conversion énergétique, ces mesures s’attaquent à la source du problème d’une consommation élevée. Elles ne changent pas seulement la provenance de l’énergie, elles réduisent la quantité d’énergie nécessaire en premier lieu.
Les impacts du retard
Négliger ces mesures d’efficacité énergétique en profondeur n’affecte pas que les bâtiments pris isolément, mais l’ensemble du système énergétique. À mesure que de plus en plus de bâtiments passent à l’électricité sans être optimisés pour utiliser moins d’énergie, la pression sur le réseau augmente. Cela crée un enchevêtrement de défis interreliés:
- Capacité du réseau: Des bâtiments inefficaces stimulent la demande globale d’électricité, forçant les services publics à investir dans une infrastructure plus imposante pour gérer des pics de charge qui auraient pu être bien plus faibles après une rénovation en profondeur. En rendant les bâtiments plus efficaces, on allège la pression sur le réseau, on réduit les coûts d’infrastructure et on obtient des réductions d’émissions plus durable.
- Sécurité énergétique: Les bâtiments inefficaces restent vulnérables aux fluctuations soudaines des prix des combustibles et aux interruptions de l’approvisionnement en énergie. En réduisant leurs besoins énergétiques sous-jacents, ces bâtiments deviennent plus résilients et mieux préparés à faire face aux turbulences du marché et aux perturbations externes.
- Électrification? Pas possible sans efficacité: Si les bâtiments demeurent inefficaces, ils exigeront des quantités disproportionnées d’électricité pour répondre à leurs besoins. Autrement dit, plus le parc immobilier est inefficace, plus le nombre de bâtiments pouvant passer des combustibles fossiles à l’électricité de façon durable est limité.
Une approche équilibrée, qui combine conversion énergétique et mesures d’efficacité énergétique en profondeur, constitue la clé d’une transformation significative. Pour y parvenir, plusieurs ajustements de politiques publiques s’imposent:

- Codes du bâtiment couvrant tous les bâtiments: Au-delà de la construction neuve, les codes doivent aussi fixer des normes d’efficacité strictes pour les rénovations majeures des bâtiments existants. Ainsi, chaque modernisation rapprochera le bâtiment d’un niveau d’efficacité optimal.
- Intégration de l’efficacité et de la conversion énergétique: Imposer simplement le passage des combustibles fossiles à l’électricité ne garantit pas la réduction de la demande. Les décideurs devraient exiger qu’un projet de conversion énergétique inclue également les améliorations d’efficacité identifiées.
- Incitatifs pour des améliorations globales: Des mesures financières, comme des crédits d’impôt ou des remises offertes par les fournisseurs d’énergie, devraient récompenser les projets intégrant à la fois améliorations d’efficacité et électrification. Le soutien devrait par ailleurs tenir compte de la valeur à long terme de ces mesures, plutôt que de s’arrêter aux solutions rapides.
- Monétiser les émissions évitées: Les améliorations d’efficacité en profondeur ne réduisent pas seulement les émissions directes d’un bâtiment, elles peuvent aussi « libérer» de la capacité sur le réseau et contribuer à éviter le déploiement de nouvelles centrales de production. Ces « émissions évitées» peuvent parfois être quantifiées et vendues sous forme de crédits carbone, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour les propriétaires et favorisant encore davantage les investissements dans l’efficacité.
Alors que le Canada continue d’assainir son approvisionnement en électricité et de développer son parc immobilier, il doit dépasser le simple enjeu de la conversion énergétique. Le véritable progrès réside dans l’alignement des efforts d’électrification avec des améliorations ambitieuses et durables de la performance énergétique des bâtiments.